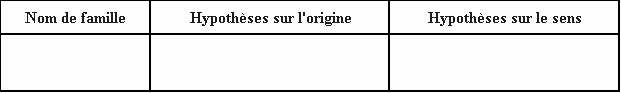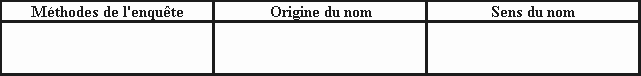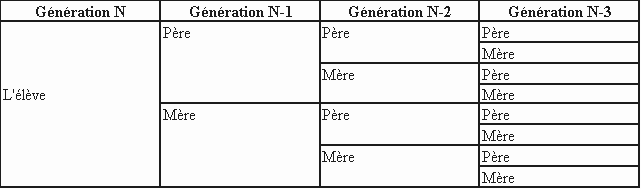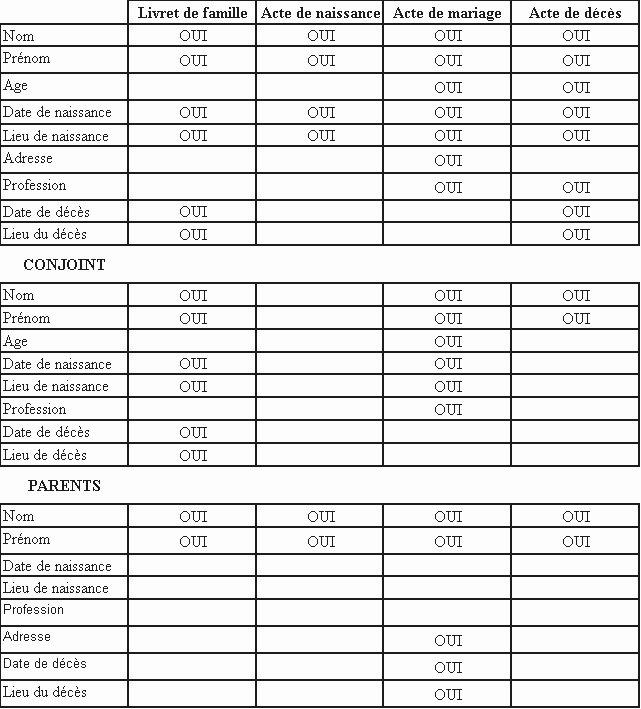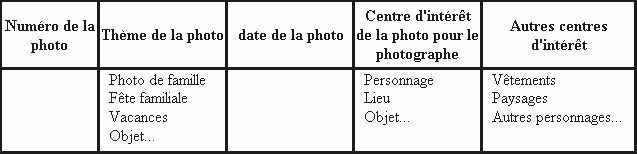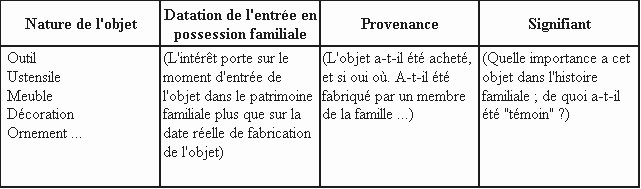Quel projet pédagogique ?
Le projet proposé ici pourrait s'inscrire dans le travail mené en module dans des classes de BEP sur une ou deux années (seconde ou seconde et terminale). Il vise à intéresser les élèves à leur propre histoire et donc à les faire s'interroger sur leur passé et conduirait à la réalisation d'un document écrit et illustré proposant des itinéraires particuliers d'élèves et celui d'un groupe classe. Puisqu'il va s'agir de fouiller la mémoire familiale, il est bien évident que des précautions s'imposent :
Élaboration : les pôles d'investigation
L'approche proposée ici n'est pas à proprement parler une séquence, mais plutôt une série de pistes à exploiter au cours de la réalisation du projet. Les pôles d'investigation pourraient être les suivants :
Recherche patronymique
La rencontre avec une classe est d'abord la rencontre avec des noms souvent divers et parfois chargés d'histoire. Au-delà de l'identité administrative, le nom est chargé de sens. L'enseignant tient dans l'étude du patronyme le lancement qui lui permettra d'intéresser l'élève. C'est à partir de lui qu'il va pouvoir bâtir son travail. Les questions qui vont provoquer l'enquête (le début du travail de l'historien) sont des plus simples:
Les investigations peuvent commencer et il faut espérer que la curiosité des élèves sera titillée. Faut-il orienter la recherche des élèves ? La tentation est forte de le faire mais il sera plus porteur de leur poser ces questions en fin de séance, de poser des hypothèses sur ce que l'élève sait ou croit savoir sur ce sujet puis de leur demander de rechercher de manière plus "scientifique" le sens de leur nom et enfin de répertorier lors d'une séance ultérieure les démarches suivies. Cette méthode offre l'avantage de ne pas limiter les pratiques d'enquête et de laisser à l'élève une part d'autonomie plus importante. L'élève pourrait être muni de grilles dans lesquelles il notera les éléments suivants :
Grille à remplir en classe :
Cette première activité est déterminante pour la suite du programme. Elle doit et stimuler la curiosité des élèves et être, en classe, l'occasion d'échanges qui amorceront un voyage dans l'espace et dans le temps.
Dans un deuxième temps les élèves vont rechercher pour confirmer ou infirmer les hypothèses développées lors de la première séance. Là encore les élèves compléteront une grille qui sera discutée dans une séance ultérieure :
Grille à compléter en autonomie :
Dans un troisième temps, les élèves présentent les résultats de leurs recherches. A ce stade, deux perspectives sont exploitables. La première porte sur la confirmation ou pas des hypothèses de départ. L'élève a-t-il découvert quelque chose qui l'intrigue ? L'étonne ? Le surprend ? Éprouve-t-il le besoin d'aller plus loin ? La seconde perspective interroge l'aspect méthodologique. Comment l'élève s'y est-il pris pour répondre aux questions posées ? A-t-il rencontré des difficultés ? A-t-il consulté des sources écrites ou orales ? A-t-il la certitude que les réponses obtenues sont fiables ? A-t-il pratiqué une double vérification ?
Le but n'est pas de faire de l'élève de lycée professionnel un futur chercheur mais de le familiariser à une approche critique des sources et de lui faire prendre conscience des difficultés qu'on peut rencontrer lorsque l'on veut répondre à des questions même d'apparence simple.
Ce travail sur les patronymes peut s'élargir en pratiquant une classification des noms. Le nom de l'élève est-il fréquent ou pas. Trouve-t-il son origine dans la géographie (nom de pays, de région, nom local ...), dans l'aspect physique, dans une profession, dans un lien de parenté ...
Recherche généalogique
Très naturellement, l'étape suivante de l'enquête va porter sur la généalogie. D'abord parce qu'elle permet d'étendre les investigations non pas à un mais deux parents (une étude du nom patronymique de la mère peut se révéler d'ailleurs très intéressante). Ensuite parce que la généalogie introduit l'idée de chronologie. Enfin parce qu'elle amène à s'interroger sur des sujets plus complexes et oblige à une recherche plus poussée que celle de la première étape. Là encore il serait intéressant de laisser les élèves trouver par eux-mêmes les pistes à suivre. Suivant le même principe que lors de la première activité on pourra poser des hypothèses portant cette fois non sur l'objet de la recherche mais sur la méthode :
La recherche généalogique est d'autant plus intéressante pour l'élève qu'elle oblige à une rigueur d'approche et à une confrontation des sources. L'élève peut orienter ses investigations dans trois directions:
Une grille peut aider l'élève à consigner les résultats de ses investigations :
Les informations à inscrire sur la grille seraient pour chaque personne les suivantes :
Pour obtenir ces renseignements l'élève peut consulter quatre types de documents:
L'approche généalogique remplit l'un des objectifs fixés par l'enseignant : éveiller la curiosité de l'élève. Il est probable qu'au cours de ses recherches, il découvrira des morceaux de son histoire et il appréciera l'importance du document et de sa bonne analyse pour trouver les réponses aux questions posées. Le paysage familial étant créé, l'élève va essayer de donner de l'ampleur à ce qu'il a trouvé. Pour ce faire, il peut exploiter les documents photographiques et les objets domestiques.
Documents photographiques
La photographie est devenue extrêmement populaire dans les années 60. Il est donc intéressant de tenter de retrouver dans la collection familiale et aussi loin que cela est possible toute information gravée sur la pellicule qui donnera vie à ce qui n'est qu'écrit. L'élève abordera cette recherche sous deux angles :
L'objectif est donc d'analyser une photo en deux temps. L'élève doit pouvoir détailler ce qu'elle dit puis ce qu'elle ne dit pas mais qui est pourtant imprimé. Dès qu'il aura fait son tri, l'élève complétera une grille d'analyse comme celle-ci :
L'élève doit parvenir à extraire du document photographique toutes les informations qu'il peut contenir afin d'élargir la connaissance qu'il a du passé familial. Une observation attentive générera peut-être des questions pour lesquelles il souhaitera trouver des réponses.
L'analyse des objets
Il n'y a pas que la photo qui soit vectrice de souvenirs. Les objets tiennent dans l'étude du passé une place prépondérante. Il n'y a pas de neutralité dans ce qu'on garde ou ce qu'on jette. Et ce qui échappe au rebut est là soit par contingence économique, soit parce qu'il parle d'un passé :
Arrivé à cette étape, l'élève se livre à un travail "d'archéologie" familiale. Il va devoir interroger les objets à sa disposition, interroger ceux à qui ils appartiennent et extraire le signifiant potentiel de ces objets. Dès qu'il a trié les objets l'intéressant, l'élève pourrait être amené à se poser deux types de questions :
Là encore, l'analyse rigoureuse des objets peut être consignée dans une grille :
L'entretien
L'élève est donc muni de précieuses informations qui l'ont fait plonger dans son passé familial. Peut-être reste-t-il des blancs dans le puzzle qu'il est en train de construire. Il peut éventuellement combler les trous en interrogeant ceux ou celles (oncles, tantes, cousins ...) qui pourraient lui fournir des détails supplémentaires. A ce niveau, la grille de questions n'est élaborable qu'en fonction des problèmes rencontrés.
L'utilisation immédiate
Arrivés au terme de cette première partie, les élèves se retrouvent munis d'un certain nombre de données et documents. Ils ont en leur possession :
Non seulement ils ont aiguisé puis nourri leur curiosité, mais ils ont trié pour ne retenir que ce qui leur semblait essentiel. Ainsi, ont été réalisés certains des objectifs déclinés dans les Instructions Officielles ("Répondre à la curiosité des élèves", donner "le sentiment des solidarités qui les lient à ceux qui les ont précédés", "distinguer l'essentiel de l'accessoire", faire "saisir les racines" ...).
Vient alors le temps du dépouillement. Il s'organisera en deux temps. D'abord il visera à exploiter au niveau familial les informations collectées. Puis les résultats obtenus s'inscriront dans l'histoire plus large.
Niveau familial
Chaque élève va, à partir de son matériel documentaire, tenter de construire une synthèse dont l'axe principal sera le repérage des continuités ou/et des ruptures dans l'histoire familiale.
L'élève à cet instant peut tracer dans le temps et dans l'espace les lignes forces de l'histoire de sa famille. Cette deuxième étape de l'exploitation des documents au niveau familial va introduire au repérage. Les activités élèves sont multiples. En voici trois exemples :
Ce travail de recherche puis de synthèse mené par l'élève est arrivé au terme de sa première étape. Il dispose de tout un matériel au travers duquel il peut écrire une histoire de sa famille. Ce matériel est diversifié et lui a fait apprécier la multiplicité des sources documentaires. Il a peut-être rencontré des difficultés, un document qui, par exemple, en dément un autre ; si sa curiosité a été éveillée, il aura tenté de les surmonter. Ce faisant, il aura été dans l'obligation d'apprécier à leur juste valeur chaque pièces à sa disposition. Il se sera interrogé sur ce que veut dire chaque source, sur son importance réelle ou relative dans son histoire ... Il aura utilisé les documents et en aura extrait ce qui lui semble recevable puis l'aura réécrit, lui aura donné une autre dimension. Et pour arriver à ce résultat, il sera sorti pendant quelques heures du cadre scolaire ! Ce qui, dans le contexte du lycée professionnel n'est pas à négliger. En particulier dans le domaine d'une matière générale parfois très éloignée des préoccupations immédiates de l'élève.
Fort de ce capital, l'élève peut aborder la deuxième étape qui le fera passer du particulier au général.
Niveau collectif
Le but de cette deuxième partie vise à inscrire la mémoire familiale de l'élève dans la mémoire collective. En partant du travail réalisé, l'élève peut être amené à se poser deux types de questions:
La première interrogation suppose un répertoire relativement précis des grands événements de l'histoire survenus dans le cadre chronologique imposé à l'élève par l'histoire familiale (naissance des grands-parents par exemple). Pour répondre judicieusement, une activité de recherche, de sériage et de tri est fondamentale. Dans un premier temps l'élève va donc réaliser un "paysage" historique lui permettant de tracer un nouvel axe chronologique qui pourrait être organisé en plusieurs niveaux : le niveau local, le niveau régional, le niveau national et le niveau international. L'échelle de cet axe devra être la même que celle retenue pour celui réalisé précédemment. Ensuite, l'élève comparera les deux axes. Il découvrira alors les points de rencontre entre l'histoire de sa famille et l'histoire générale. Enfin, il pourra interroger ses parents (au sens large) sur le souvenir qu'ils gardent des événements répertoriés. Éventuellement, il pourra les questionner afin de savoir s'ils ont été spectateurs ou acteurs de ces événements. Cette étape est probablement la plus emblématique du travail mené par l'élève car elle construit un pont, elle établit très objectivement le lien qui peut exister entre mémoire et histoire et lui fait apprécier les enjeux que soulèvent cette relation. L'histoire fige le passé alors que la mémoire est vivante:
"La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. L'histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n'est plus."(3)
Tel ou tel événement de l'histoire prend telle ou telle valeur suivant qu'il se nourrit de l'expérience familiale ou pas. Ainsi, la guerre peut sembler lointaine lorsqu'elle est abordée dans le cadre scolaire ; elle peut même émouvoir, faire réagir ... Mais elle prend une ampleur bien plus significative si le nom d'un membre d'une famille est inscrit, gravé sur un monument aux morts. Elle s'apprend dans le contexte scolaire et se raconte dans le contexte familial. Si l'élève, au travers des recherches qu'il a effectuées, s'appropriant un morceau d'histoire exprime le souhait d'en parler et s'il accepte que d'autres puissent faire la même chose, alors le travail mené aura tenu ses promesses. C'est d'ailleurs la partie la plus riche de ce projet.
La seconde interrogation amènera l'élève à comparer le parcours de sa famille au parcours moyen des autres membres d'une collectivité donnée. Ce parcours est-il conforme à celui des contemporains ? Il peut ainsi vérifier si, par exemple, les mouvements migratoires concernant sa famille sont typiques ou atypiques. Si les modifications socio-économiques s'inscrivent en similitude à celles de groupes plus importants. L'intérêt de cette partie est de motiver l'élève à connaître les grandes évolutions du monde dans lequel il vit et de les comparer à son expérience privée.
Le travail mené par l'élève dans le cadre du module l'a donc conduit à des investigations poussées dans son histoire. Il a été amené à se pencher sur sa propre histoire et sur l'histoire collective. Il a du chercher des documents et les interroger. Il en a retenu certains et rejeté d'autres. Il a été un enquêteur. Il a essayé de synthétiser les informations retenues. Il les a confrontées à l'histoire collective. On peut dès lors espérer que sa relation à l'histoire en bénéficiera et qu'il aura un regard très concerné par ce qui le touche ou touche les autres. Cette histoire est aussi la sienne ; qu'il en soit à son tour spectateur ou acteur, il en est au moins le témoin et à ce titre sa responsabilité est engagée.
____________________________________________________________________________________
Notes :
(1) Guy de Maupassant, Une vie (1883) (2) Paul Auster, L'invention de la solitude (1982) (3) Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Tome I La République (Gallimard - 1984) |